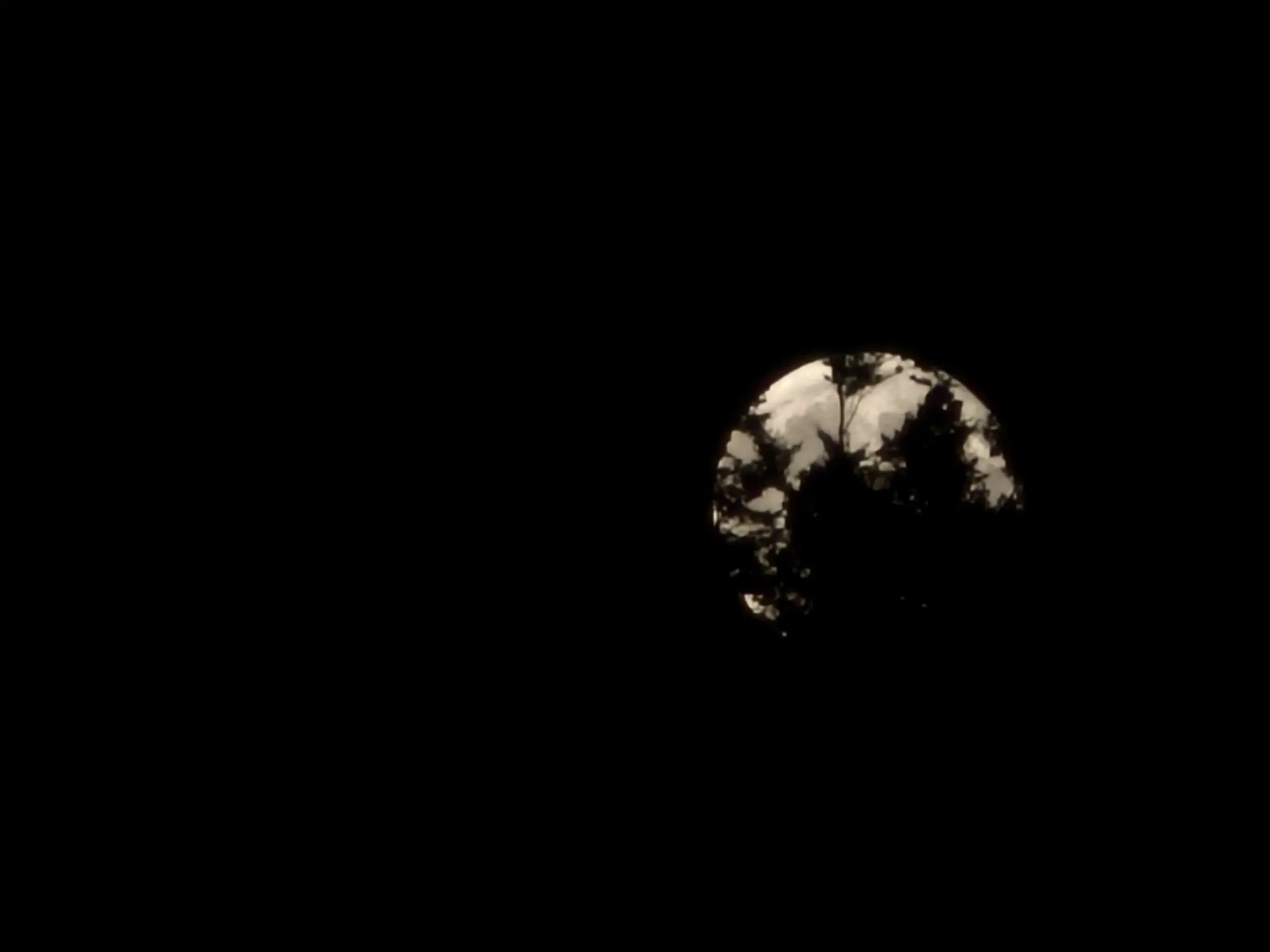
Par ce recueil, j’invite le lecteur à un périple qui zigzague entre le cœur des émotions humaines, certains mystères du monde et les paradoxes du langage, là où le mot rencontre la chose sans qu’il ne la devienne jamais ni ne réussisse à l’évoquer dans toutes les dimensions de sa résonance subjective. L’exploration que je propose n’est pas un compromis. Dans les ombres de l’aube, elle aborde la vie et la mort, l’être et la naissance, le temps et la mémoire, l’amour et la solitude, l’émotion et le corps, la nature et le cosmos, la finitude et l’oubli. Elle questionne également la place de la poésie dans le langage, et celle du langage dans la poésie. Le ton des textes oscille entre rêve lucide et réalité crue, douceur d’une caresse et violence d’une gifle, doute du désir et désir de doute.
Les mots existent par leur musicalité et leur couleur, mais avant tout, ils sont matière que la création veut pétrir à pleines mains, sans interdit. C’est dans cette création que se joue la capacité du verbe à blesser ou à sauver, à évoquer par l’ellipse ou à crier par besoin d’explosion ou goût de la brutalité. L’émerveillement côtoie la mélancolie, la persistance du passé chatouille l’éphémère. Corps, parole, langage et douleur deviennent des jouets de l’imaginaire, parfois inconfortables, jamais simplement là pour distraire. Écrire devient alors catharsis, par la voie — ou la voix ? — d’un ludisme parfois subversif.
J’ai tenté de faire en sorte que les textes jalonnent un continuum — celui de mon auto-interrogatoire au jour le jour — où la vie, le corps, l’autre, le langage, la mémoire et l’univers s’interrogent, s’interpellent et se répondent en permanence. La poésie y devient prétexte à explorer les contradictions de l’existence : la fragilité et la force de notre architecture personnelle, l’absence qui nous accable parce que nous ne lui sommes pas simultanément absents, la violence que nous exprimons parfois de la pire des manières, et la beauté qui nous met souvent à genoux.
La poésie est un mensonge !
En m’interrogeant sur la nature de la poésie, j’en suis arrivé à me demander si elle n’était pas essentiellement un mensonge. Loin de l’idée d’une malhonnêteté, ce mensonge tiendrait à la structure du langage et à l’essence du processus créatif. L’écriture ne restitue jamais entièrement l’expérience émotionnelle ou spirituelle qui l’a inspirée, déclenchée et nourrie. Les mots – outils et matière première de l’expression – sont intrinsèquement limités. Ils ne peuvent saisir pleinement la profondeur de l’expérience qui révolte ou subjugue, émeut ou transperce. Ce que l’on écrit et partage n’est qu’un retour, un écho lumineux de la pensée ou de l’émotion originelle. Le non-dit, la mémoire silencieuse, l’indicible restent inaccessibles, quoique omniprésents, à la manière de fantômes dont on sentirait la proximité sans jamais les voir.
Mais cette distance entre l’intention (ou l’émotion) et l’expression poétique n’est pas un échec. Elle est même le cœur battant de l’écriture poétique. Elle pousse à chercher, explorer, creuser les profondeurs tapies sous le moi, sans jamais pouvoir atteindre une vérité absolue. La poésie naît de cette tension : tentative et impossibilité à la fois, jeu désespéré entre branle-bas au sous-sol et imparfaite traduction textuelle à l’étage. Ainsi, le non-dit, l’ébauche et la rature contiennent peut-être plus de vérités souterraines que ce que la plume dévoile dans l’écrit.
J’ignore pourquoi, mais vient cette question : peut-on comparer la poésie à l’art abstrait ? Comme la peinture abstraite ne restitue pas littéralement les choses du monde, la poésie ne peut restituer la totalité de l’émotion, de la réaction ou du questionnement qu’elle aspire à mettre en mots. Ce décalage structurel entre pensée, émotion, mot et lecture est universel. Mais là n’est pas tout. En effet, tout comme l’admirateur fixé par un monochrome qui se dérobe à lui en même temps qu’il l’hypnotise, le lecteur projette sa propre sensibilité sur le texte et devient, à son insu, « menteur-complice ». En lisant, il cherche, inévitablement depuis les abysses de son propre registre subjectif, à interpréter quelque chose qui, fatalement dès la mise en mots, avait déjà échappé à l’auteur. Dès lors, qui comprend quoi ?
Pourtant, ce mensonge est nécessaire et vital. C’est de ce décalage irréductible que l’écriture devient créative, vivante, intensément jubilatoire. Il en résulte que la poésie est un art de l’approche, de la suggestion, de l’éclair fugitif. Elle transforme l’auteur et le lecteur, et par eux le langage, même s’il y a toujours un reste insaisissable. L’impossibilité de réduire ce dernier n’est aucunement une faiblesse, mais la condition de la puissance poétique et de sa capacité à révéler quand même un feuillage alimenté par des racines intérieures. Tout se joue dans l’effort que fait l’indicible pour se manifester dans une forme au minimum lisible, idéalement sensible, à défaut d’être parfaitement décodable – donc pleinement intelligible.
Jean-Christophe Cassel, auteur du livre De l’aube les ombres.
